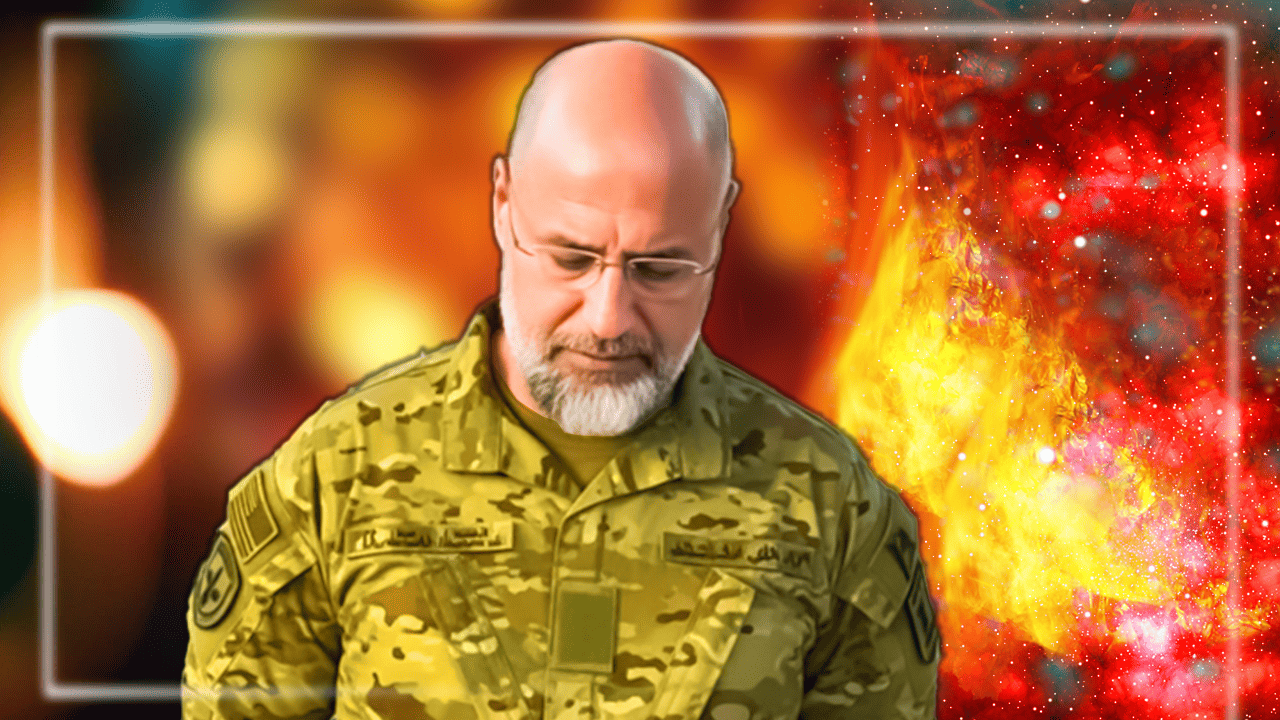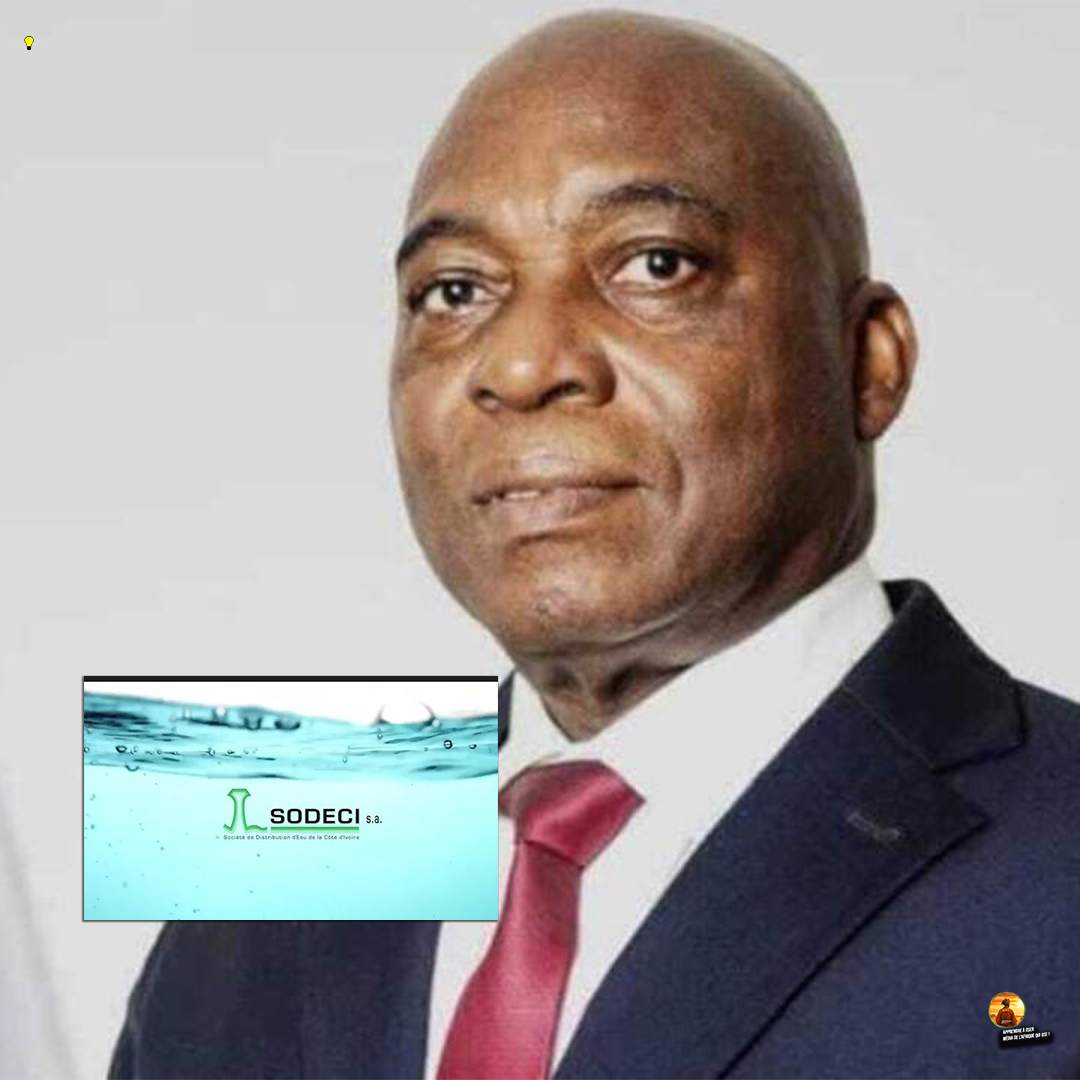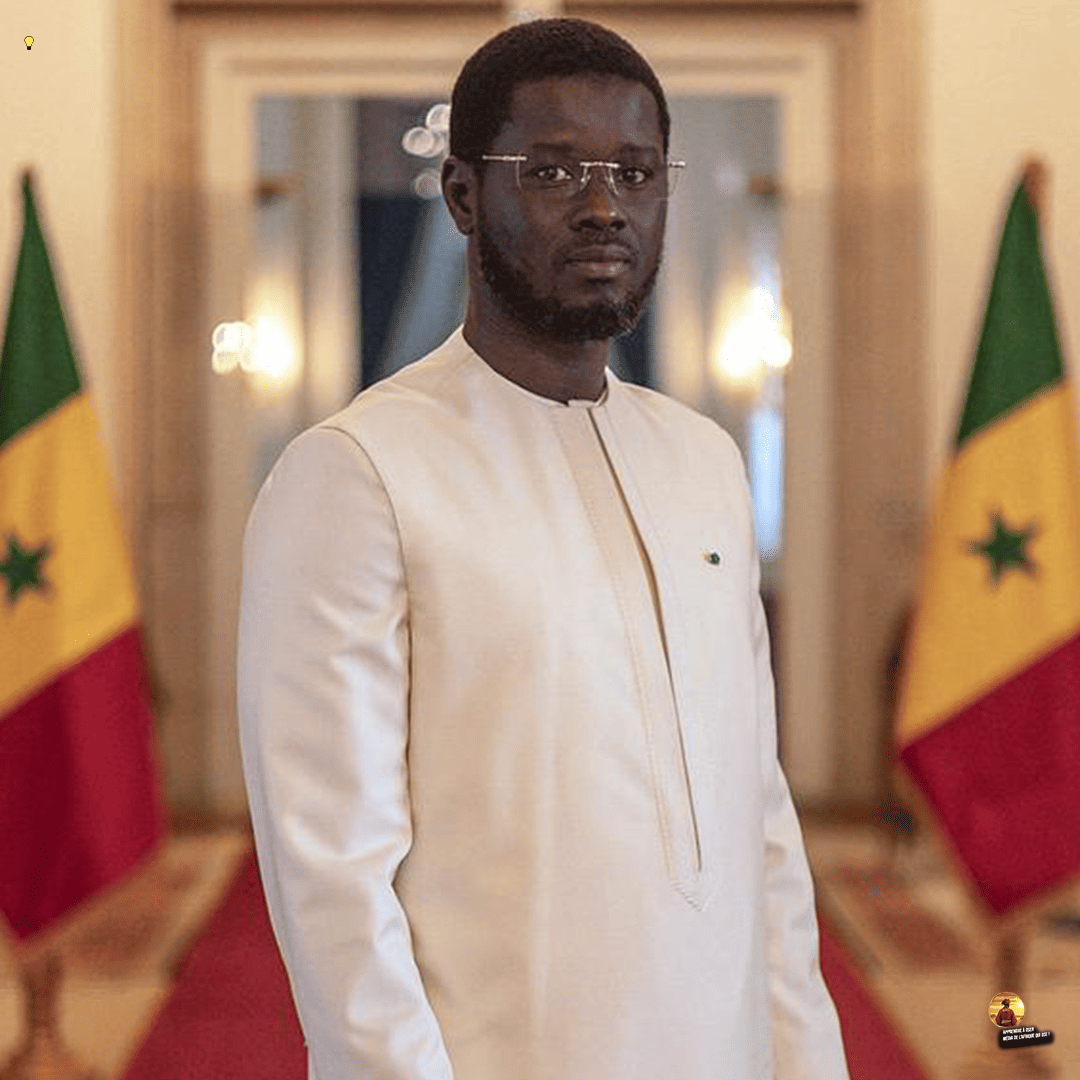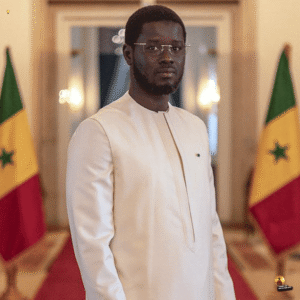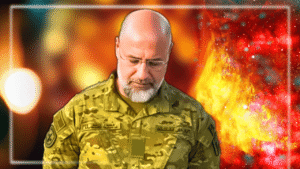Restitution des trésors africains : un pas dans la bonne direction, mais la route reste longue
La France s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le processus de restitution des biens culturels africains pillés pendant la colonisation. Si des avancées notables ont eu lieu depuis la promesse d’Emmanuel Macron en 2017, le chemin reste encore long. Face aux milliers d’objets toujours conservés dans les musées français, les États africains attendent désormais des actions plus audacieuses, durables et respectueuses de leur patrimoine.

Une volonté réaffirmée de réparer le passé
C’est une avancée qui mérite d’être saluée. À la fin de ce mois de juillet 2025, le gouvernement français remettra sur la table du Parlement un projet de loi destiné à faciliter les restitutions de biens culturels spoliés durant la colonisation. Cette initiative, attendue de longue date, marque un tournant dans les relations entre la France et l’Afrique.
Elle fait suite à une promesse historique faite par Emmanuel Macron en 2017, lors de son discours à l’université de Ouagadougou, dans lequel il affirmait vouloir permettre le retour du patrimoine africain en Afrique. Depuis, 27 objets ont été restitués, dont 26 au Bénin. Un début encourageant, mais encore trop timide au regard des enjeux.
Des gestes symboliques porteurs d’espoir
Les quelques restitutions déjà effectuées ont été accueillies avec fierté et émotion dans les pays concernés. Elles ont permis de renouer avec des pans entiers d’histoire, de culture et d’identité, longtemps confisqués.
Le retour des trésors royaux d’Abomey au Bénin, par exemple, a suscité une vague d’enthousiasme et a renforcé la dynamique culturelle et patrimoniale dans le pays. Ces objets ne sont pas de simples œuvres d’art : ils incarnent la mémoire, la résistance et la grandeur des civilisations africaines.
Une nouvelle loi pour simplifier les démarches
Jusqu’à présent, chaque restitution nécessitait une loi spécifique, ce qui rendait le processus extrêmement lent. Le nouveau texte que le gouvernement français souhaite faire adopter vise à instaurer un cadre légal global, permettant aux musées de restituer plus facilement des objets sur demande justifiée.
C’est une réforme structurante, qui montre une réelle volonté politique. Elle devrait faciliter les demandes formulées par une dizaine de pays africains, dont l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou Madagascar.
Il reste des milliers de trésors encore enfermés
Mais malgré ces avancées, le chemin reste long. Des milliers d’objets africains sont encore conservés dans les musées publics français, en particulier au musée du Quai Branly. Selon les estimations, près de 90 000 pièces d’origine africaine s’y trouvent, souvent sans information complète sur leur provenance.
Il est donc essentiel que cette dynamique de restitution s’intensifie et s’institutionnalise, pour répondre aux demandes croissantes et légitimes des pays africains. Car rendre à l’Afrique son patrimoine, c’est contribuer à restaurer sa mémoire, son identité et sa dignité.
Pour une coopération culturelle équitable
Cette nouvelle étape ne doit pas être perçue comme un acte de charité ou de bonne volonté ponctuelle, mais comme une forme de justice historique, et surtout, comme un engagement vers une coopération culturelle nouvelle.
Il ne s’agit pas simplement de « rendre », mais de travailler ensemble à valoriser ces patrimoines, à les exposer, à les transmettre aux jeunes générations africaines et à en faire un levier de renaissance culturelle.
Enfin: Encourager, mais surtout continuer
La France est en train d’ouvrir une porte importante. Le projet de loi attendu en juillet est un signal fort. Il traduit une reconnaissance des blessures du passé et un désir de dialogue plus équilibré avec les anciennes colonies.
Mais la symbolique ne suffit pas : il faut que les actes suivent. L’Afrique est prête à accueillir ses trésors. Elle attend de ses partenaires, non pas des faveurs, mais le respect de son droit à la mémoire.
Car restituer, c’est reconnaître. Restituer, c’est réparer. Restituer, c’est reconstruire.